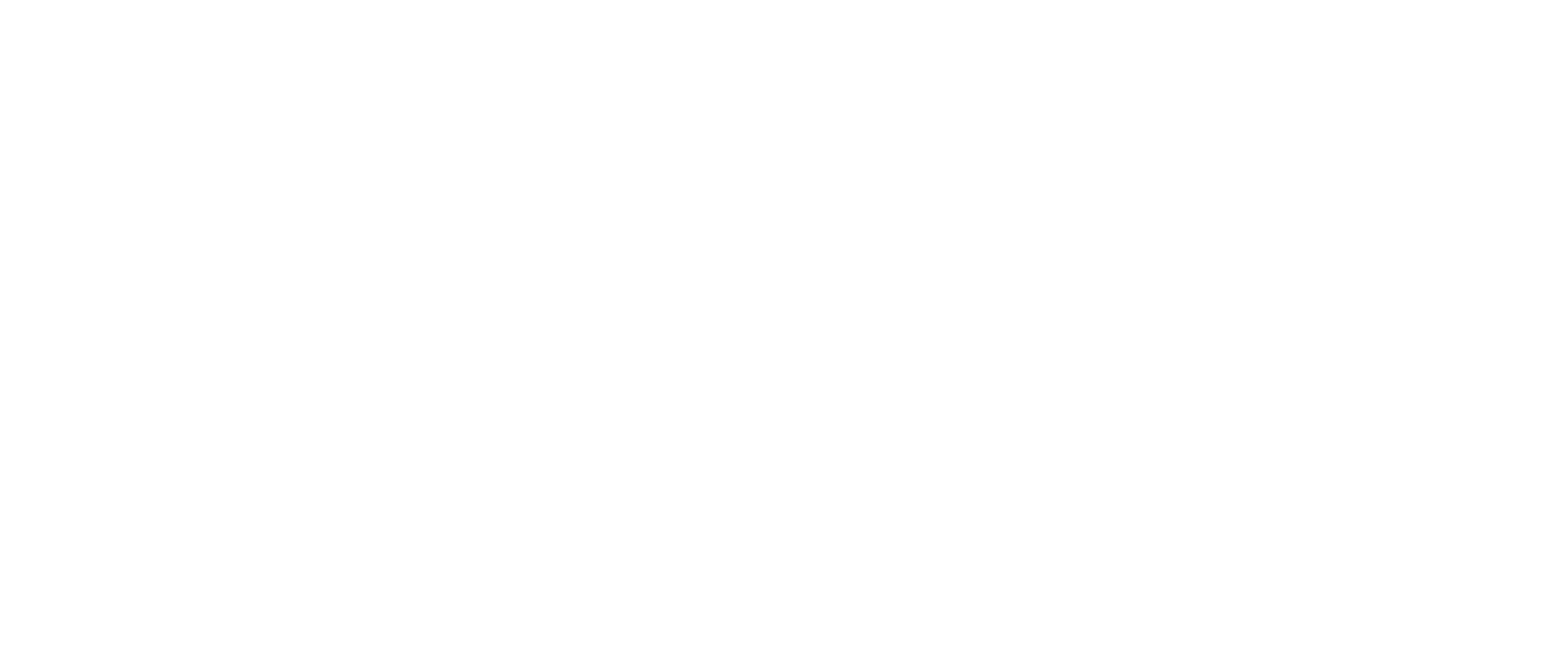LIBERTÉ OU VIOLENCE ?
« Le gang bang est-il une atteinte à la dignité humaine ? » : la justice face aux soirées sexuelles
La légitimité de soirées sexuelles organisées dans le local commercial d’un immeuble du 15e arrondissement de Paris, fait débat au tribunal administratif du 4ᵉ arrondissement de Paris.
par
Flore Cherry
Publié le 06/02/2026 à 21h37
La légitimité de soirées sexuelles organisées autour de scénarios de gang bang dans le local commercial d’un immeuble du 15e arrondissement de Paris, fait débat.
Dans la salle d’audience du tribunal administratif situé rue de Jouy, à Paris, deux camps se font face lundi 2 février et pourraient presque être distingués à la couleur des cheveux : longues tresses brunes chez les participantes venues soutenir l’organisateur de soirées Z., brushing carré grisonnant chez les habitantes d’un immeuble du 15ᵉ arrondissement, ulcérées par l’une des activités qui se déroule dans le local commercial de leur copropriété.
À première vue, l’affaire ressemble à une guerre de voisinage classique. Paris en produit chaque semaine ; des riverains excédés par une activité jugée incompatible avec la tranquillité de l’immeuble. Mais ici, le litige ne porte ni sur un bar trop bruyant ni sur une cuisine odorante. Il concerne des soirées sexuelles organisées autour de scénarios de gang bang. Pour les plaignantes, il s’agit d’une activité intrinsèquement attentatoire à la dignité humaine. Pour les participantes, d’un espace de fantasmes consentis.
« Des hommes en tenue BDSM »
Le conflit, régulièrement alimenté par la presse locale avide de récits croustillants, a rapidement dépassé la simple querelle immobilière. La préfecture, prise entre la crainte du scandale et l’absence de plainte pénale formelle, ordonne d’abord une mise aux normes d’accessibilité pour personnes handicapées. Le gérant engage les travaux.
Puis, après la mise en conformité et l’ouverture, nouveau coup dur pour l’exploitant. Une fermeture administrative est ordonnée en urgence pour atteinte à la dignité humaine et à la morale publique. La défense dénonce une contradiction manifeste. S’il y avait urgence morale, pourquoi avoir laissé engager des frais ? Pourquoi six mois d’inaction avant une décision soudaine ?
Quelques témoignages évoquent un « climat anxiogène » et de nombreux signalements ont été adressés aux autorités. Pourtant, aucune infraction pénale n’est constatée, aucune victime déclarée et aucune plainte déposée. D’autant que l’activité existe depuis une quinzaine d’années. À la barre, une habitante affirme avoir déjà croisé « des hommes en tenue BDSM » en descendant ses poubelles avec sa fille mineure. « Comment expliquer ça à un enfant ? », lance-t-elle. Le tribunal ne dispose pourtant d’aucun élément matériel venant étayer ces scènes.
La question du consentement
Le président du tribunal se retrouve ainsi contraint de trancher non seulement l’urgence administrative, mais la question de fond : l’État peut-il interdire une pratique sexuelle consentie au nom de la dignité humaine ?
L’attaque développe une thèse claire. Ces soirées ne relèveraient pas du libertinage classique. « Le déroulé du rapport est précisément déterminé », plaide l’avocate de la préfecture. Là où un club libertin laisserait place à l’initiative individuelle, ces événements reposeraient sur un scénario écrit dont l’objet serait la transformation de la femme en pur objet sexuel, en produit de commercialisation. Le consentement, soutient-elle, ne suffit pas à tout légitimer. On ne peut pas juridiquement consentir à sa propre dégradation lorsqu’elle devient marchandise.
Elle évoque des mises en scène d’agressions sexuelles simulées, des injonctions humiliantes, des hommes cagoulés, des gestes violents intégrés au spectacle. Elle brandit des photos d’hématomes, cite des témoignages parlant de tirages de cheveux et d’étranglements. « C’est la banalisation d’une culture de viol », conclut-elle. Selon cette lecture, le problème n’est pas moral mais structurel : commercialiser une humiliation reviendrait à institutionnaliser une atteinte à la dignité humaine. Dans l’audience, certaines jeunes femmes lèvent les yeux ciel.
La défense renverse la perspective. Ces pratiques existent, plaide l’avocat, qu’on le veuille ou non. Les interdire ne les fera pas disparaître, mais les déplacera dans des lieux clandestins, sans cadre ni sécurité. Ici, au contraire, tout reposerait sur le consentement explicite des participantes, des règles strictes, des codes d’arrêt, des scénarios validés à l’avance.
La liberté sexuelle face à la notion de dignité humaine
Selon l’organisateur, les participantes choisissent les modalités, les partenaires ainsi que leurs limites. Et surtout, elles paient aussi pour l’organisation de leur fantasme, une trentaine d’euros. À ses yeux, la fermeture administrative revient à infantiliser des femmes adultes au nom d’une morale que l’État n’a pas à imposer. La défense invoque la jurisprudence européenne, notamment le droit au respect de la vie privée qui inclut la liberté sexuelle, y compris lorsque celle-ci choque ou dérange.
Le débat quitte alors le terrain du voisinage pour s’aventurer sur la notion de dignité humaine. Cette valeur a déjà servi à interdire des spectacles jugés dégradants ; le plus célèbre étant l’arrêt du Conseil d’État de 1995 sur le « jeté de nain ».
Dans cette affaire, un maire avait interdit un spectacle consistant à projeter une personne atteinte de nanisme dans une discothèque. L’intéressé lui-même contestait l’interdiction et affirmait consentir librement à cette activité, qui constituait son moyen de subsistance. Le Conseil d’État avait pourtant validé l’interdiction au nom d’un principe supérieur : la dignité de la personne ne peut être aliénée, même avec l’accord de la personne concernée.
Cet arrêt, devenu un cas d’école en droit administratif, a permis d’instaurer l’idée que certaines pratiques peuvent être interdites indépendamment du consentement individuel, parce qu’elles portent atteinte à une valeur collective jugée fondamentale. Mais sa transposition à la sexualité consentie reste explosive. Les avocats s’affrontent sur la comparaison : d’un côté, on invoque une jurisprudence protectrice des personnes vulnérables ; de l’autre, on souligne que le gang bang ne vise pas une catégorie discriminée et repose sur des participantes revendiquant leur autonomie.
Peut-on protéger quelqu’un contre son propre consentement ? Et comment placer la frontière entre sexualité extrême et atteinte objective à la personne ? Dans la salle, les deux camps ne parlent plus seulement d’un local commercial. Ils s’affrontent sur deux visions du corps féminin. Pour les unes, la marchandisation du fantasme est indissociable d’une violence symbolique. Pour les autres, interdire ces pratiques revient à nier la capacité des femmes à disposer librement de leur désir.
Le tribunal devra trancher. Mais au-delà de cette affaire, la judiciarisation croissante des pratiques sexuelles rouvre une interrogation plus dérangeante : à l’heure où l’accès à la pornographie est fait de plus en plus limité, jusqu’où une démocratie libérale peut-elle encadrer nos plus intimes fantasmes sexuels ?